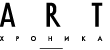Retrospective








Brassaï. «L'Ombrelle blanche», 1934. © Estate Brassaï-RMN
Brassaï. «Marlène Dietrich», 1937. © Estate Brassaï-RMN
Brassaï. «Jardin exotique de Monaco», 1945. © Estate Brassaï-RMN
Brassaï. «Place de la Concorde», 1945 © Estate Brassaï-RMN
Brassaï. «Ciel postiche», 1934. © Estate Brassaï-RMN
© Estate Brassaï-RMN
Brassaï. «La Tour Eiffel», 1932. © Estate Brassaï-RMN
Brassaï. «Jean Marais posant pour Picasso», 1944. © Estate Brassaï-RMN
Moscow, 1.08.2012—7.10.2012
exhibition is over
Share with friends
For the press
Il portait son nom, ou plutôt son pseudonyme comme un étendard. Et pourtant Brassaï, né Gyula Halasz en 1899 dans cette partie de la Roumanie alors sous domination austro-hongroise, ne rêve que de la France, fasciné par la langue et la culture que lui avait révélées son père professeur de Français à l’université.
De son premier voyage à Paris, à l’âge de quatre ans, il revient avec des images si intenses qu’il se promet d’y retourner pour étudier le dessin. Toutefois la première guerre mondiale met fin à ce souhait car après avoir servi dans l’armée austro-hongroise, il lui est interdit, comme à tous les citoyens des ex pays ennemis de séjourner en France. Il décide donc de se rendre à Budapest pour suivre une formation artistique auprès de Mattis-Teutsch, peintre expressionniste hongrois . De ce jour , il ne reviendra une fois seulement dans son pays et souffrira de se sentir un éternel immigrant, même après qu’il eût acquis la nationalité française.
Il quitte son maître — qui, selon ses dires, lui a appris le sens de la forme et des couleurs — pour rejoindre Berlin en 1921.
Débute ainsi sa vie d’artiste alors qu’il est en proie aux doutes passagers sur sa vocation, aux crises existentielles et morales, aux difficultés financières provoquées par l’inflation, mais aussi aux enchantements et à l’exaltation des émotions esthétiques.
Ecrivain en devenir, il engage dès ses années berlinoises une correspondance régulière et continue avec ses parents ; ces lettres demeurent merveilleuses de naïveté, de fraîcheur mais aussi de certitudes. «Combien de faux pas, d’égarements, d’illusions, de balourdises, voire de stupidités !» avoue-t-il dans l’une d’elles.
Après avoir réussi le concours d’entrée à l’Académie des Beaux Arts de Berlin, il se réjouit ouvertement de pouvoir disposer d’un modèle pour lui seul, ce qui le conduit à composer un impressionnant corpus de dessins dans lesquels on retrouve la facture contrôlée, quasi géométrique, d’un Kandinsky ou d’un Moholy-Nagy, tous deux formés à l’aulne du constructivisme et qui, avec Kokoschka, figurent parmi les proches de Brassaï.
Avec une clairvoyance peu commune, ce jeune artiste de 22 ans énonce ainsi sa pratique du dessin : «Quel rythme il a, le corps humain ! Je possède déjà complètement la construction du nu. Je construis le nu exactement comme il apparaît dans la nature. Et, si nécessaire, je pétris librement les formes dans ma représentation (parfois même au détriment de l’anatomie et des proportions)».
Dès lors on comprend mieux ses recherches dans le domaine de la sculpture qui concernent pour l’essentiel la représentation de la figure humaine — du nu principalement — déhanchée, disproportionnée mais toujours voluptueuse.
Peut-être est-ce aussi à cette époque et dans ces circonstances qu’il a appris à distinguer, dans le mouvement de la rue, les formes généreuses des femmes dont il apprécie le mouvement du dos et la cambrure des reins.
Toutefois il délaisse bientôt les cours, jugeant l’enseignement trop traditionnel et estimant que son «épanouissement ne peut se faire que par des études individuelles». Et puis, pour dire le vrai, ses journées sont chargées de conquêtes féminines, de discussions entre amis qui font évoluer sa pensée, et de divers travaux qui sont sensés subvenir à ses besoins. Il réalise ainsi des gravures sur bois, sur cuivre et sur zinc plus faciles à vendre que ses peintures et moins personnelles que ses dessins et court toujours après les quelques marks supplémentaires qui lui permettront de conserver son atelier ; il écrit pour ce faire des articles politico-historiques pour les journaux hongrois et autrichiens qui oublient le plus souvent de le rémunérer.
Au cours des trois années passées à Berlin qui furent non seulement un temps d’apprentissage, mais aussi l’occasion de se livrer à l’introspection et de réaliser un important corpus artistique — peintures, dessins, gravures -, Brassaï acquiert la certitude de vouloir consacrer sa vie au domaine artistique, quelles qu’en soient les conséquences matérielles ; et ceci, il en est certain, ne peut se faire qu’à Paris où l’a déjà précédé son ami et mentor le peintre Lajos Tihanyi. Dès son arrivée en janvier 1924, il écrit à ses parents qu’il se sent en harmonie avec la ville «son terrain de combat où il étudie comment Paris vit et bouge, mais aussi comment les hommes bougent avec elle».
En fait, malgré l’inquiétude de ses parents qui craignent de le voir perdu pour «l’art», il met en place, sans en être encore vraiment conscient, le processus de création photographique qui lui vaudra la célébrité : tel un Balzac il observe les mœurs de ses contemporains, de tous ses contemporains quelles que soient leur nationalité ou leur origine sociale , mais aussi l’environnement dans lequel ils évoluent.
Et ceci donne lieu à la publication de deux ouvrages célèbres : Paris de Nuit et Paris Secret.
Il a pris conscience de ses nombreuses dispositions artistiques, refuse selon ses propres termes, la spécialisation et revendique l’inlassable curiosité de l’érudit. A Paris, il a la conviction de pouvoir bientôt faire épanouir tous ses talents.
Pour l’heure, il déborde d’activité. Pour s’affranchir des problèmes linguistiques, il se consacre à l’étude régulière de la langue française, reportant sur une multitude de petits carnets les expressions idiomatiques ou le vocabulaire peu commun dont usent et abusent ses amis surréalistes. Pour résoudre ses problèmes matériels, il s’essaye à la caricature pour les journaux français et allemands et adresse régulièrement aux magazines autrichiens, hongrois ou roumains des chroniques sur les sujets que son imagination lui fait aborder sans complexe : comptes-rendus d’expositions, critiques sur des concerts, articles sur le Salon de l’Agriculture ou match de rugby France-Roumanie... Bien qu’il réalise en outre des dessins humoristiques pour des magazines sportifs et reçoive de temps à autre les commandes de quelques riches mécènes, la vie matérielle continue à être difficile et il craint de gâcher son talent en tentant de survivre.
Aussi, à la tombée du jour, rejoint-il avec émerveillement la rive gauche et ce monde d’artistes, d’intellectuels, d’étrangers, d’aventuriers et de demi-mondaines qui ont fait la légende du quartier de Montparnasse. Au fil de la nuit, il entreprend André Kertesz — son compatriote — à la Coupole, mais aussi Salvador Dali et Ribemont-Dessaignes et lorsque plus tard il arrive à la Rotonde, il poursuit la conversation engagée la veille avec Man Ray qu’accompagne le plus souvent Kiki. Bientôt la présence d’Henry Miller ajoute une note d’étrangeté à ces nuits aventureuses et, dans ces circonstances, le projet Paris de Nuit lui devient une évidence.
En effet, depuis quelques temps déjà, les rédacteurs en chef des journaux auxquels il collabore lui demandent d’accompagner ses chroniques de photographies ; il sollicite dans ce cas ses amis photographes, parmi lesquels Kertesz, Rogi André ou Ergy Landau, puis il s’essaye lui-même peu à peu à cette discipline. A l’exemple de Man Ray qui s’est initié à la photographie pour reproduire ses peintures, Brassaï s’engage dans cette voie pour illustrer ses articles. Très vite pourtant, il avoue ne pas se contenter de cette seule fonction illustrative de la photographie et dès 1929, époque où il réalise ses premières images, il comprend que ce médium lui permet d’obtenir des effets, des émotions esthétiques singulières qu’il ne peut réaliser avec la peinture.
Il a encore à l’esprit l’évocation d’un Paris inconnu qu’Atget vieillissant, et qu’il admire, regrettait de ne pouvoir fixer assez vite avant qu’il ne disparaisse. Mais alors qu’Atget plantait sa chambre photographique dès les premières lueurs du jour pour échapper aux promeneurs, Brassaï fait de ces derniers le sujet essentiel de son œuvre et en digne émule de ses amis surréalistes qu’il fréquente au quotidien et qui ont excité sa curiosité, il se passionne pour l’art brut et les cultures primitives puis cultive un goût prononcé pour l’étrange, la différence et la vie nocturne. Il rejoint Atget dans sa quête de la réalité mais s’essaye à transcender le réel en surréel, selon ses propres termes, en traquant dans la lumière nocturne de la ville un Paris insolite, inconnu, méprisé. Il compose cette magistrale leçon des ténèbres au fil de ses longues déambulations qui le mènent seul ou en compagnie d’Henry Miller, Blaise Cendrars ou Léon-Paul Fargue de Montparnasse à Montmartre, voire à Clichy.
Cette quête très personnelle, il la conduit à la seule lumière des phares, aveuglants mais aussitôt disparus, puis à celle plus floue et mystérieuse des becs de gaz ; il ne veut rien ajouter au décor, il observe à travers l’objectif posé sur son trépied et attend, la cigarette aux lèvres — car elle détermine le temps de pose — que la situation déjà entrevue, souvent repérée s’offre à nouveau à lui.
Alors il rend visibles les humbles — prostituées ou travailleurs de la nuit -, transforme la rigueur classique de l’architecture parisienne en scènes insolites et fixe l’étrange beauté des silhouettes fugitives, des illuminations scintillantes ou des brouillards sur la Seine.
L’ouvrage est prêt à paraître fin 1932 et s’avère une véritable révélation car jamais jusqu’alors un photographe n’avait eu l’audace d’inscrire le jeu de l’obscurité, de l’ombre, de la pénombre et a contrario des éclats de lumière, au cœur de son œuvre. Le succès est immédiat et met Brassaï en contact avec les revues d’art les plus célèbres et les magazines internationaux les plus réputés.
Il va ainsi publier régulièrement dans Minotaure — où la série sur les madrépores et les sculptures involontaires lui vaut l’admiration de Salvador Dali et d’André Breton qui, subjugué, lui demandera d’illustrer l’Amour fou — ou dans Verve qui lui confie de nombreux sujets.
Puis le 2 octobre 1935, il porte sur son carnet journalier cette notation : «accablé de commandes — Mais relation la plus importante : Harper’s Bazaar et sa directrice Carmel Snow veulent publier deux photos de moi, chaque mois sur deux pages et proposent 3 000 francs — Cette affaire traîne par ma négligence depuis un an». Ainsi débute une collaboration de près de trente ans avec Carmel Snow et Harper’s Bazaar pour lequel il réalise des reportages écrits et photographiques.
Les années 30 constituent , dans le parcours de Brassaï, une période d’une incroyable fécondité créatrice. Sans exclusive, il travaille aussi bien pour les revues les plus contemporaines dans le domaine de l’art, que pour les magazines les plus populaires. On retrouve ainsi ses personnages marginaux dans Verve, Art et Médecine ou Bifur, mais aussi dans Paris-Magazine ou France Tabou...
La seule différence consiste dans sa capacité de mise en scène des personnages pour les magazines populaires : cambriolage de voyous, attaque nocturne dans les cours parisiennes tandis que sa fréquentation des bars à la mode lui permet de photographier, sans trop de problèmes les filles de joie, les homosexuels, les habitués des bals populaires que l’on retrouvera dans son ouvrage Paris Secret . Il côtoie tous ces personnages, attise leur confiance, prend le temps de poser son regard et son appareil sur eux, comme il le fit avec cette incroyable série sur ces noctambules qui se reflètent dans un miroir.
Mais n’oublions pas que Brassaï est en outre un homme de conviction ; aussi refusant au lendemain de la guerre les horreurs qui ont mis à mal la vie humaine, il poursuit avec obstination le travail aussi déroutant que solitaire qu’il avait engagé pour le Minotaure et traque sur les murs de la ville ces signes mystérieux porteurs de la parole des disparus, ces traces magiques gravées contre l’oubli, cet art populaire au cœur de la création intemporelle que sont les graffiti.
Il déchiffre la vie dans la lecture du mur, il pose un regard attendri sur les serments gravés dans les arbres, il établit la chronologie du monde en visitant la ville, la prison, les murs des cavernes et ceux de l’usine.
Une autre rencontre majeure fut celle qui le conduisit à photographier tout l’oeuvre sculpté de Picasso et , au fil du temps, ses divers ateliers, puis à composer ses Conversations avec Picasso qui retracent leurs échanges au jour le jour sur l’art et la vie pendant plus de trente ans.
Agnès de GOUVION SAINT-CYR